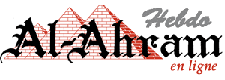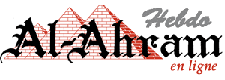Dans ce texte inédit Khouf (peur), le Libanais
Hassan Daoud
retrace, avec sincérité poignante qui relève du récit
véridique, l’attente de la fin. A travers le fantôme
d’aujourd’hui, la maladie du cancer, qui survient
machinalement dans notre quotidien.
Peur
Quand le médecin me parla
de ma maladie, je fus pris, une fois de plus, par le
sentiment très fort de ne pas laisser filtrer ma peur devant
lui. Je savais déjà ce qu’il allait me dire depuis qu’il
m’était apparu sur le pas de la porte, le visage sombre et
silencieux, gardant encore les vêtements qu’on porte en
salles d’opérations. Il demanda à mon neveu qui
m’accompagnait à l’hôpital de nous laisser un moment. Dès
que ce dernier quitta la pièce, le médecin s’approcha de la
porte et referma la poignée. J’allais comprendre, quel que
soit ce qu’il me dirait, que j’étais atteint de la maladie
que je craignais. De toute manière, il ne nomma pas la
maladie. Il m’annonça, alors que j’étais installé sur le
siège des visiteurs, qu’il y avait quelque chose dans
l’échantillon prélevé. La peur survint fortement. En moins
d’une seconde, la sueur envahit mon corps et une vague de
chaleur et de vertige me monta à la tête. Je me vis en train
de fixer le carrelage de la pièce alors qu’il ajoutait que
ce que j’avais ne menaçait pas ma vie. Cela n’amoindrit pas
ma peur pour autant. Je ne lui jetais pas de regard lui
demandant d’ajouter un détail qui me réconforterait. Je
voulais simplement qu’il me laisse seul pour me sauver de la
gêne d’afficher ma peur devant lui. Aller aux toilettes pour
essuyer ma sueur avec la grande serviette, puis sortir dans
l’étroit balcon, afin que le vent que je savais sec et rare
essuie mon visage.
Je m’étais préparé à
entendre ce que le médecin m’avait annoncé. Pas pour savoir
que j’étais atteint par la maladie, mais pour dissimuler ma
peur de la maladie. Depuis des mois avant ce jour, ou même
des années, je sentais cette maladie qui s’approchait de moi,
elle seule et aucune autre. Je ne craignais pas d’être
atteint d’une maladie de cœur, deuxième mal que redoutent
les gens. Je l’avais choisi en quelque sorte, elle entre les
deux, le lion et pas le tigre. Je frissonnais et devenais
moite de sueur lorsque quelqu’un en parlait devant moi.
Comme si j’avais planté sa graine en moi et l’avait soignée
pour qu’elle grandisse jour après jour jusqu’au moment de sa
venue.
Le médecin, qui ne
prolongea pas sa visite, ne nomma pas la maladie. Il me dit
alors qu’il s’apprêtait à tourner la poignée de la porte, de
m’apprêter à sortir tout de suite et de venir le voir à la
clinique le lendemain ou le surlendemain. Un ou deux jours
de repos comme il le pensait et également pour me rassurer à
l’idée que la maladie n’était pas rapide et que rien ne
changerait en moi, durant un ou deux jours.
Bélal, mon neveu, qui ne
tarda pas à réapparaître, semblait savoir ce que j’avais. Un
seul regard furtif, terrifié et investigateur, puis il
baissa les yeux pour regarder dans le vague n’importe quoi.
J’avais oublié mes affaires en allant au balcon, mais la
serviette se trouvait étendue entre mes mains comme si elle
demandait que je la sèche de la sueur, encore toute chaude,
qui l’avait mouillée à l’instant. Je dis en me redonnant des
forces, parce que j’étais son oncle et qu’il était mon neveu,
que nous irons voir le médecin dans un ou deux jours.
Pourtant, ma voix me trahit, je l’entendis faible et fine
comme si c’était la voix d’un enfant. Même devant lui, mon
neveu qui n’était pas âgé de plus de dix-sept ans, je me
trouvais en train de dissimuler ma peur. Je pensais qu’en
arrivant chez moi, je recommencerai devant ma femme qui
savait certainement, ayant trouvé quelqu’un pour téléphoner
au médecin pour lui demander des nouvelles. Egalement, mes
jeunes enfants à qui je devrais parler comme si de rien
n’était. Les gens qui viendraient me rendre visite pour me
voir malade après avoir appris que je l’étais vraiment.
Ensuite, mon père qui sortira ses yeux un moment de leur
égarement et qui me fixerait en repoussant ma main portant
la cuillère à sa bouche.
Je dis à Bélal, alors que
je ramenais la serviette aux toilettes, de m’apporter ma
emma, mon couvre-tête, de l’armoire. Dans le miroir, mon
visage m’apparut comme si la peau était devenue plus tendre
et qu’il était devenu plus rouge à cause de la sueur qui en
avait émané. Lorsque Bélal me rapporta ma emma ; la tenant
de ses deux mains, à l’envers, il me dit que je ne pouvais
pas quitter ma chambre avant qu’on ne me l’autorise. Moi
aussi j’avais besoin de temps avant de sortir dans le long
corridor qui longeait les chambres aux portes ouvertes. Car
on ne se contentera pas uniquement de me regarder alors que
je le longeais, mais on me saluera et il me faudra répondre
aux saluts. « Salut à vous », je devrais répondre d’une voix
claire à chaque fois que quelqu’un me lancera en se tournant
vers moi : « Salut à vous, notre cheikh ». Dans un film que
j’avais visionné, le médecin contempla ses poumons tout
noirs sur la radiographie, puis il dit à un collègue se
tenant à ses côtés : « Je n’ai plus beaucoup de temps ». Il
fit cette remarque ainsi, comme si cette radio allumée
devant lui était une chose qu’il voyait tous les jours ou
comme s’il regardait ses poumons comme il le ferait pour les
poumons de ses malades. Au moment où j’avais vu le film, je
pensais que les gens plus ils grandissaient, plus ils
devenaient aptes à se maîtriser, quel que soit ce qui se
passait dans leur tête.
La vague chaude qui me
donnait le vertige devint plus forte dans ma tête et
m’épuisa. Sur la route, lorsque nous sortîmes de l’hôpital,
mon neveu me demanda s’il était préférable de louer une
voiture pour nous ramener à la maison. Cela me faciliterait
les choses, mais je me dirigeais vers ma voiture garée dans
la rue, surplombant la rue de l’hôpital. Mon neveu me suivit
en sautillant derrière moi, en essayant de me rattraper et
de marcher à mes côtés. Les gens accouraient comme s’ils
participaient à une course pour arriver à la portière de
l’hôpital. Quant à moi, je devais être alerte apprêtant mes
deux mains à repousser ceux qui pourraient se cogner à moi.
Ce qui augmenta ma fatigue tellement que je me retournais
tous les deux pas pour me rassurer que mon neveu était
proche. Il savait pourquoi je voulais qu’il soit proche et
il me répétait : « Je suis derrière toi, oncle ».
Les trois jours qui
s’étaient écoulés avaient rempli la voiture de poussière et
l’avaient salie. Toutefois, il existait une distance
suffisante devant la voiture pour m’épargner d’avancer et de
reculer plusieurs fois. Après m’être installé et posé mes
mains sur le volant, mon neveu me demanda si j’avais quelque
chose pour éliminer ce qui se trouvait sur le pare-brise.
Les tâches de saletés étaient collées à la vitre, grasses et
denses. Je me retournais à la recherche de la boîte de
kleenex sans vraiment être intéressé à la trouver. Alors que
je m’arrêtais de chercher, posant ma tête pour la reposer
sur le dossier du siège, mon neveu introduisit ses mains
entre le volant et moi pour faire fonctionner la lave-vitre.
Il n’en sortit pas de sons telle une ondulation légère qui
m’était familière et dont la mission était de sécher. Sans
me regarder ou piper mot, mon neveu se retourna vers les
magasins qui se trouvaient sur l’autre côté de la route. Il
sortit de la boîte qu’il venait de rapporter un paquet de
mouchoirs et se mit à sécher la tâche grasse et dense qui
paraissait impossible à supprimer. Elle avait fait corps
avec la vitre et il devait revenir au magasin pour rapporter
une bouteille d’eau. Mais avant qu’il ne reparte, je lui fis
signe de revenir à sa place, bien que je sache que cette
tâche allait demeurer devant moi tout au long du chemin à me
fatiguer les yeux et à me dégoûter.
Les quatre-vingt kilomètres
qui me séparaient de ma demeure n’ajouteraient pas à ma
fatigue, ils me reposeront même si la route devant moi
demeurait vide de voitures. En plus, la fatigue qui
m’emplissait n’allait pas me donner sommeil. La femme qui
était venue du Venezuela pour habiter chez nous ne cessait
de répondre à mon père à chaque fois qu’il lui demandait à
propos de sa maladie, le sommeil … le sommeil … disait-elle
cela d’une voix rauque et électrique qui sortait de sa gorge
trouée. Nous savions, nous, les habitants de la demeure,
qu’elle ne dormait jamais, ne cessant de sortir des voix de
la précipitation de sa respiration, de l’ouverture de ses
valises et de ses allées et venues entre sa chambre à
coucher et la cuisine au fond de la maison. Elle n’avait pas
dormi cette nuit non plus, disait ma mère à la première
personne qui se réveillait le matin d’une voix dont elle
faisait attention de n’être pas entendue par la femme qui
pouvait se trouver n’importe où : derrière ma mère alors
qu’elle parlait ou proche de la porte de la salle de bains
ouvertes alors que je me lavais le visage et les oreilles ou
encore dans le corridor entre les chambres, debout, bien
qu’il n’y avait rien à y faire. Ma mère ne rechignait pas,
ne se plaignait pas non plus et ne disait pas à mon père qui
d’autre que nous pouvait accepter d’abriter une femme qu’il
ne connaissait pas. Bien plus, elle disait en s’apitoyant
sur le sort de la femme que c’était une pauvre femme qui ne
connaissait personne et qu’elle était venue du Venezuela car
elle ne voulait pas mourir là-bas.
Et la femme accomplit ce
pourquoi elle était venue, chez nous à la maison. Mon père
pénétra dans la pièce où elle était étendue et il dit à ma
mère, debout près de lui, qu’elle était morte. Ainsi, sans
relever ses paupières pour voir le blanc de ses yeux ou sans
lui tenir la main pour voir si son pouls continuait à battre.
Elle est morte, dit-il, puis il se retourna pour sortir de
la chambre comme si rien de ce qui suivrait ne devait se
faire.
Le sommeil. Je sentais
combien il serait éloigné et difficile malgré l’épuisement
et l’incapacité de supporter le son d’un chien accourir pour
traverser la rue devant moi. Ma mémoire était fixée sur
cette femme alors qu’elle se tenait devant la porte de la
cuisine en tenant de ses doigts ce morceau de fer qui
sortait de ce trou où se trouvaient sa voix et sa
respiration. J’apprenais alors à l’âge de neuf ou de dix ans
la maladie et son nom dans ce petit endroit vide sous son
cou. « Elle a la maladie du cancer », ma mère chuchotait ces
deux mots à ses visiteuses, la maladie et son nom, comme si
elle leur faisait savoir ce qu’elles n’avaient jamais connu.
Elles recevaient ce qu’elles écoutaient terrorisées et
apitoyées. En fait, elles le connaissaient, mais comme s’il
avait été inscrit dans de vieux livres et qu’on les en
informait.
Dès qu’on ait atteint
l’autostrade, j’arrêtai la voiture et je dis à mon neveu
Bélal de descendre de l’auto pour enlever cette tâche que je
fixais à chaque fois que mon regard se portait dessus. Il ne
trouva rien de mieux que la clé qui était dans sa poche et
il se mit à gratter le pare-brise en faisant un bruit sec.
Puis, il me regarda pour savoir s’il lui fallait arrêter ce
son qui pourrait égratigner la vitre. Je tardai à lui
répondre à cause de ma rêvasserie et ma paresse. Il me dit,
lorsqu’il revint à son siège, qu’elle ne sortirait qu’avec
de l’essence. Ses paroles me sortirent de ma méditation,
mais pour un instant, je me demandai comment il savait ce
que les chauffeurs faisaient pour supprimer les tâches qui
se collaient à leurs voitures.
— Tu sais conduire ?
Je lui demandai après être
sorti, à cause de ce qu’il connaissait de l’essence, ne
serait-ce qu’un instant de ma pensée maladive.
Et lui, le connaisseur de
ce qui se passait en moi, attendit que ma question revienne
une seconde fois. Mais comme je ne le fis pas, il se
contenta de se retourner vers moi puis vers l’autostrade qui
s’étendait devant nous.
Traduction de Soheir Fahmi