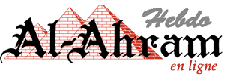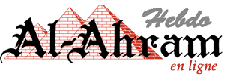Ibrahim Nasrallah,
écrivain palestinien, couvre dans son roman épique Zaman
al-khoyoul al-bayda 60 ans de l’histoire de son peuple,
depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à l’occupation en 1948.
Si la sagesse arabe dit que Dieu a créé le cheval à partir
du vent, et l’homme de la poussière, l’écrivain ajoute « et
les maisons des gens qui y habitent ». Une division qui
répond aux trois chapitres du roman.
Le
temps des chevaux blancs
«
Je ne me bats pas pour gagner, mais pour défendre mes droits
»
Le héros du roman
Les deux tours en bois de la colonie disparurent subitement.
Tout le monde le remarqua. Elles faisaient partie de manière
intrinsèque de la colonie à tel point que personne ne
pouvait l’imaginer sans leur présence. Les gens n’y
comprirent rien. Comment cela avait-il eu lieu alors que le
feu sortait de partout ?
— Ils vont quitter les lieux. C’est sûr qu’ils vont le faire
puisqu’ils ont su que les armées de secours arrivaient.
— S’ils veulent partir, en quoi ont-ils besoin des deux
tours ? Lorsqu’on part, on prend ce dont on a besoin.
Peut-être prendront-ils leurs maisons qui se sont abattues
du ciel, subitement. Mais les deux tours …
Et comme si la chose tenait du miracle, ils virent une
nouvelle tour monter à la place de la tour nord. Elle
grimpait largement du sol devant leurs regards ahuris. Ils
ne virent personne autour de la tour pour leur permettre de
penser que des gens y travaillaient. Le travail se faisait
entièrement à l’intérieur. Après trois jours, elle devint
plus élevée que n’importe quel bâtiment du village, plus
haute que toute élévation. Tout en haut apparurent les
ouvertures de combat semblable à une personne qui ferme un
œil comme pour mieux voir.
***
— Ils ne jouiront pas de ce qu’ils ont construit ici puisque
les armées de secours arrivent, dit le haj Salem.
— Vous êtes étranges, mon cousin, dit-elle. Comme si vous
n’aviez rien appris de ce qui vous est arrivé en 36. Vous
continuez à agir avec les leaders arabes à la manière du
bédouin et de son histoire avec le panier de figues !
Pourtant, vous avez insulté ces leaders à ne plus en finir !
Et lorsqu’il lui demanda : Que veux-tu insinuer. Elle
raconta : Un bédouin porta un panier de figues et partit
avec ses bêtes vers les montagnes avant le lever du soleil.
Il mangea le matin quelques figues en s’imaginant que
quelqu’un viendrait lui apporter le déjeuner à midi. Il jeta
un coup d’œil vers les figues et commença à grommeler :
Mauvaises figues. Figues pourries. Il en vint même à pisser
sur les figues. Mais il fut pris par la faim à midi, et
personne ne vint. Il attendit, mais le déjeuner n’arriva
pas. Il regarda alors le panier de figues avec consternation
puis il dit : Cette figue n’a sans doute pas été touchée par
la pisse et il la mangea, et celle-ci, et il la mangea
également, et celle-là, et il fit de même. Il finit par
engloutir tout ce que contenait le panier, en croyant ses
dires.
Puis elle se tut et poursuivit : Si c’est la première fois
que vous mangez des figues, je pourrai dire, c’est la
volonté de Dieu. Mais ce que vous mangez, que Dieu nous en
préserve ! C’est de la merde.
***
Le soleil de ce jour n’avait pas encore illuminé toutes les
places du village et les recoins de ses cours. Ils
entendirent alors un coup de feu suivi d’un hurlement.
Personne ne comprit ce qui se passait, à l’exception de ceux
qui étaient sur la place. Ils virent un homme se tortiller,
le visage contre la poussière. Ils le retournèrent et ils
découvrirent que ce n’était personne d’autre que Tamim
Abou-Daya. Le coup de feu avait traversé son cœur. Ils se
retournèrent pour en connaître la source. Mais ils
n’aperçurent personne. Et de loin, la colonie apparaissait
calme et les pierres de la tour étaient éclairées par la
lumière matinale.
Le lendemain, les choses se passèrent de la même manière.
Dans la deuxième ruelle, tout près de la porte de l’échoppe
d’Abou-Rihi, une femme se mit à hurler, puis elle tomba à
terre. Les gens accoururent vers elle. C’était Leïla Hassan,
la mère de Nayef. Ils ne savaient plus s’ils avaient entendu
des coups de feu avant son cri ou pas. Ils scrutèrent toutes
les directions, mais ils ne virent personne. Le calme que
revêtait la tour et la distance qui la séparait de l’endroit
apparaissaient si lointains que l’on ne pouvait d’aucune
manière douter que les coups pouvaient parvenir de là-bas.
Le troisième jour, personne ne fut atteint. Tout se passa
dans le calme. Ils en vinrent à croire que ce qui s’était
passé les deux jours précédents n’était qu’un cauchemar,
sans plus. Mais ils ne pouvaient oublier qu’ils avaient
suivi deux linceuls de tués.
Le quatrième jour, un coup de feu se fit entendre. Ils
n’auraient pu ne pas le remarquer. Ils devinrent plus
alertes. Abdallah Rachid était tombé près du moulin à blé.
Sa femme Torkeya Al-Moussa se mit à hurler et à geindre sur
son cadavre. Puis elle se leva et appela au secours. Et elle
n’avait pas fini d’hurler qu’un coup de feu l’abattit
au-dessus du cadavre de son mari. Le village se pressa vers
elle non sans précaution. Il y avait eu déjà deux morts.
***
Gabr Darwich confirma que la balle était venue de la tour.
Oui, de la tour, et de nulle part ailleurs. Il avait aperçu
son éclat. Ils ne purent croire que quelqu’un pouvait
atteindre un homme à une distance aussi lointaine que celle
qui séparait la première maison de Hadya des barbelés de la
colonie.
Il dit : J’y vais et je vais m’assurer par moi-même avant
l’aube. Je vais observer et comprendre. Abbass Rachid lui
dit : Je t’accompagne. Le sang de mon frère et de sa femme
ne se transformera pas en eau.
Lorsque le soleil se leva, ils entendirent un coup de feu,
la tête de Gabr était apparue de derrière un grand rocher,
celui de la surveillance. La balle était passée sous son
œil. Il recula et sa tête tomba sur l’épaule de Abbass. Il
se trouva taché par le jet de sang et par les bouts d’os et
de chair. Et avant qu’il n’ait le temps d’ouvrir la bouche,
ils entendirent dans le village la deuxième balle.
Exactement, sous son œil gauche, la balle passa. Le sang, la
chair et les os éclaboussèrent la terre auprès de lui.
Tout mouvement disparut complètement des rues du village.
Le septième jour, arriva une force de l’armée du secours.
Son commandant rencontra Béchir Al-Haj et les grands du
village.
— Dès aujourd’hui, il n’y a plus de raisons d’avoir des
milices. C’est une guerre d’armée traditionnelle. Il dit
cela avec une confiance qui les interloqua.
— Mais les juifs ne nous font pas la guerre en tant
qu’armées mais comme milices. Pourquoi n’agirons-nous pas de
la même manière ? Et pourquoi nous empêcher de défendre nos
maisons ?
— Les ordres sont clairs. Il n’y a de place ici que pour les
guerres d’armées.
Ils rassemblèrent les armes qu’ils parvinrent à trouver et
se mirent à creuser les tranchées sur tous les alentours de
la colonie dans la partie intermédiaire entre les limites du
village et les barbelés. Ils lièrent cette longue ligne de
tranchées au village à travers une tranchée en zigzag.
Les gens furent étonnés qu’aucun coup de feu ne fut tiré sur
les personnes qui creusaient.
Mais la mort tapa à la porte du village à nouveau lorsque
l’enfant Yéhia Ayad tomba raide. Il avait douze ans. Ils
partirent voir Wassef Béchir. Il ne fit rien. Et tous les
jours advinrent de nouvelles morts.
Hag Salem vint le voir, furieux. Et avant d’ouvrir la
bouche, il fut surpris de voir l’officier pleurer.
— Qu’as-tu ?
— Tous les jours j’assiste à la mort de quelqu’un sans
pouvoir rien faire. Quelle humiliation ?
— Laisse-nous faire. Nous allons résoudre le problème.
— Qu’allez-vous faire ?
— Laisse-nous nous débrouiller.
Wassef Béchir se tut, mais Hag Salem ne revint pas chez lui.
Il se mit à marcher jusqu’à la maison de Hussein Ibn
Al-Aziza :
— Cousin, nous avons besoin de toi. Trouve un moyen pour
détruire cette tour.
— Calme-toi. J’y pensais. Nous allons la dynamiter.
— Et comment ?
— J’ai un ami qui s’appelle Ismaïl Al-Ghalyéni qui peut
fabriquer des dynamites. Je vais lui demander de m’en
fabriquer. Ainsi résoudrons-nous notre problème de manière
radicale.
— Où habite-t-il ?
— A Khalil.
— Et qui peut y arriver ?
— J’irai et je reviendrai.
Hussein revint le soir même en compagnie d’Al-Ghalyéni en
personne qui lui avait dit : Je ne pourrais fabriquer la
dynamite que si je vois la tour par moi-même.
Le matin, il observa la tour de loin. Il dit : Maintenant,
je peux travailler.
Le haj Salem partit voir le commandant de la force et
l’informa : Aujourd’hui, nous libérerons tout le monde de ce
démon.
— Mais n’oublie pas que la colonie est protégée par les
Anglais et les juifs.
— Les jeunes vont trouver une solution.
La dynamite était prête un peu avant l’aube. Al-Ghalyéni dit
: Je t’accompagne.
— Ta tâche se termine ici. Je connais mieux que toi la
région, lui dit Hussein.
— Je t’accompagnerai donc vers le point le plus proche, pour
me rassurer.
Ils marchèrent dans les tranchées jusqu’au point le plus
proche. Ils rampèrent. Al-Ghalyéni se cacha derrière une
grande pierre et chuchota à Hussein :
— N’oublie rien de ce que je t’ai dit.
— Rassure-toi (…).
Traduction de Soheir Fahmi