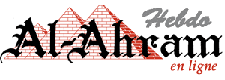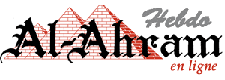Dans Al-Riwaïyoun (les romanciers, 1988),
Ghaleb Halasa,
écrivain jordanien installé en Egypte, décrit
l’univers d’une génération de militants communistes, dont
leurs expériences en prison. Il a obtenu cette année, à
titre posthume, le prix d’Encouragement de l’Etat en
Jordanie.
La prison
Le cauchemar de tout prisonnier politique, c’est qu’il ne
sait pas quand il sera libéré. Ça peut durer des mois, comme
ça peut durer dix ans, ou plus. Aucun critère précis ne
définit la durée de sa détention. Un prisonnier, Mohamad
Halabi, avait été arrêté parce qu’il portait le même nom
qu’un suspect. Il avait été arrêté plusieurs fois pour la
même raison. Un an après l’arrestation de Mohamad Halabi
numéro un, le suspect originel a été arrêté, et placé dans
le même dortoir que le Halabi emprisonné par erreur. Ce
dernier a contacté l’administration de la prison pour
exposer son cas. L’administration lui a fait savoir qu’elle
ne pouvait rien faire. Il rédigea une requête dans laquelle
il expliquait la situation. L’administration a refusé de
l’étudier ; il était interdit d’étudier les requêtes des
prisonniers.
Un jour a eu lieu l’impossible : le suspect originel a été
libéré, tandis que Halabi numéro un restait prisonnier. Les
nerfs de l’homme flanchèrent. Il se mit à raconter son
histoire à tous ceux qu’il rencontrait. Tout le monde était
au courant. Puis, ils arrêtèrent d’en parler. Quand les
prisonniers commencèrent à se montrer agacés par son
histoire qu’il répétait sans cesse, il se mit à se la
raconter à lui-même. On le voyait marcher dans le couloir,
se parler à lui-même, avec forces mimiques.
L’homme était en fait comme un avertissement hantant le cœur
de tout prisonnier. Tous tentaient d’oublier cette obsession
en bougeant perpétuellement, en se concentrant sur les
problèmes quotidiens. Au moment du coucher du soleil, juste
avant l’appel, le silence enveloppait la prison. On pouvait
alors voir les prisonniers marcher dans le couloir, un par
un, silencieux, le visage absent. Au fond d’eux-mêmes, ils
se répétaient la question de tous les jours : quand
viendrait enfin la fin de ce cauchemar monocorde ? Ces
interrogations s’appliquaient aussi à leur vie à venir à
l’extérieur.
En prison, l’image du monde extérieur était celle d’un monde
qui tournait le dos au prisonnier, un monde où les
sentiments et les rapports des gens avaient changé. Les
maisons des amis et des proches semblaient abandonnées,
occupées par des étrangers. Même Le Caire semblait devenu
une autre ville, qui ne reconnaissait plus le prisonnier,
qui l’exilait.
Pendant les premières heures de la nuit, quand les
prisonniers sont enfournés dans leurs dortoirs et que les
portes se referment sur eux, cette sensation écrasante
libère une nostalgie vaporeuse, qui touche tout le monde, en
empruntant un chemin précis. Le programme prévu pour la
soirée des communistes ce jour-là était que chacun raconte
ce qu’il comptait faire au moment où il sortirait du
ministère de l’Intérieur et se retrouverait libre. Walid dit
qu’il prendrait le premier taxi pour rentrer à la maison.
— Tu ne vas même pas marcher un peu dans la rue pour voir ce
qui s’est passé dans le monde ?, demanda Ihab, réprobateur.
— Je verrai le monde par la fenêtre du taxi. Et toi, Ihab ?
— Moi ? J’achèterai un paquet de cigarettes entier, un
paquet entier, vous entendez les gars, et je m’installerai
chez Isaevitch pour boire quatre verres de thé. Pas l’un
après l’autre. Non, je les alignerai devant moi.
— Tu n’iras pas te changer et te laver d’abord ?, demanda
Moustapha.
— D’abord les cigarettes, lui répondit Ihab, ensuite le thé.
Le reste viendra après.
Puis dans une ambiance blagueuse, se pointèrent les rêves :
« Se laver, mettre des habits propres, le thé et la
cigarette ». On demanda aux hommes mariés : « Et après ? ».
Tout le monde se mit à rire. Tous parlaient du Caire comme
si c’était une ville familière, mais en leur for intérieur,
ils la voyaient comme une ville étrangère, dans laquelle ils
entreraient en touristes.
Avec la fin de la soirée, des petits groupes se formaient,
plus intimes, et les conversations s’adoucissaient, les
sentiments s’exprimaient sans retenue. Ils racontaient des
petites histoires qui semblaient exceptionnellement belles,
avec en eux-mêmes un étonnement : dans quel monde
exceptionnel vivions-nous ? ! Est-ce vraiment la vie que
nous vivions ? Ils étouffaient de désir et de regret.
Commençaient alors les allers et venues dans cet étroit
couloir qui séparait les corps endormis, à remâcher des
souvenirs et des rêves éveillés.
Le matin, les prisonniers étaient plus optimistes. Des
rumeurs sur une prochaine libération circulaient, qu’ils
croyaient sans discuter. Il y avait un groupe que l’on
pourrait qualifier d’« optimistes chroniques ». Adli par
exemple, avec son uniforme de prison blanc, taillé dans le
tissu rêche des voiles de bateaux, sans manche ni col (Worldrobe),
son petit corps trapu, était debout dans le soleil du matin,
pour se réchauffer. Il souriait à Ihab et ce sourire
envahissait son visage tout entier, emplissant de larges
rainures éclatantes comme de l’or, et chuchota : « mabrouk
».
Ihab se sentit envahi d’un sentiment de désir impatient :
mabrouk pour quoi ?
Le sourire de Adli se transforma en un désir impatient
découvrant des dents bien alignées :
— On va être libérés.
— Libérés ? Quand ça ?
— Plus vite que tu ne le crois, répondit Adli.
Il rit, puis ajouta qu’il avait appris cela d’un officier
dans l’administration de la prison, dont il ne pouvait
divulguer le nom. Il demanda à Ihab de ne pas diffuser cette
nouvelle.
— C’est donc du sérieux, dit Ihab.
— C’est sérieux, mais n’en parle à personne.
Ihab murmura la nouvelle à plusieurs personnes. A midi, un
des prisonniers des Frères musulmans s’approcha de lui et
chuchota :
— On sera libérés bientôt. C’est sûr. N’en parle à personne.
Un matin, les communistes découvrirent que les Wafdistes
avaient rangé leurs affaires et les avaient alignées dans le
couloir, devant la porte de leur dortoir. Certains étaient
installés sur leurs affaires, d’autres restaient debout,
silencieux, ou parlaient avec les prisonniers. Ils étaient
tous rasés. Ismaïl s’approcha de Fattah et lui demanda :
— Que se passe-t-il ?
— On va être libérés aujourd’hui, lui répondit Fattah.
— Quelqu’un vous a prévenus ?, lui demanda Ismaïl.
En général, les libérations sont annoncées dans le micro de
la prison, et tous les prisonniers entendent la nouvelle.
Ceux qui sont libérés sont convoqués à l’administration de
la prison.
— Non, mais aujourd’hui on est mardi et on est le quatre du
mois.
— Oui, oui, c’est le rêve de Saïd bey, répondit Ismaïl.
Environ deux semaines après l’arrivée des Wafdistes en
prison, Saïd bey avait rêvé qu’il voyait un calendrier
accroché au mur, sur lequel était inscrit « mardi », et le
chiffre quatre, très clair. Ce rêve, pour les Wafdistes, ne
pouvait avoir qu’une seule signification : ils allaient être
libérés quand le quatre du mois tomberait un mardi. Et quand
arriva ce jour, ils considéraient que leur libération ne
faisait aucun doute. Ils restèrent donc debout près de leurs
affaires. Ils étaient tellement convaincus qu’ils avaient
repris les traits qui étaient les leurs à l’extérieur. Saïd
bey avait pris un air réservé pour s’adresser aux
prisonniers. Il regardait au loin quand ils lui parlaient.
Fattah était devenu nerveux et avait giflé Morsi, qui avait
été emprisonné avec les Wafdistes et faisait office de
domestique dans leur dortoir.
Au coucher du soleil, les geôliers passèrent dans le couloir
en criant : « l’appel ». Tous regagnèrent leurs dortoirs, à
l’exception des Wafdistes. Le geôlier Saleh Adwan s’approcha
d’eux et hurla : « l’appel ».
— On va être libérés, dit Saïd bey.
— Comment ça, libérés, cria Saleh. Entrez, tous.
Mais ils ne voulaient rien entendre. Eleiwa se retira alors
et revint en compagnie d’un officier de l’administration. Il
leur ordonna fermement d’entrer et de se préparer pour
l’appel.
— On va être libérés, mon commandant, dit alors Fattah.
— Arrêtez vos enfantillages, et entrez.
— On est sûrs qu’on va être libérés, répéta Saïd bey.
Là, l’officier s’emporta et se mit à hurler :
— Comment ça ? ! Une libération annoncée par les
prisonniers, alors que l’administration n’est même pas au
courant !
Il ne restait plus aux Wafdistes qu’à regagner leur dortoir.
Une heure après la fin de l’appel, au moment où le dîner
était distribué dans le dortoir des communistes, on entendit
des coups sur la porte du dortoir des Wafdistes, et des voix
qui appelaient de l’intérieur : « soldat ! ». La porte du
dortoir des Wafdistes fut ouverte. Peu après, la porte du
dortoir des communistes s’ouvrit à son tour. Eleiwa apparut
:
— Un médecin pour le dortoir des Wafdistes.
Parmi les prisonniers communistes, il y avait trois
médecins. L’un d’entre eux se leva et suivit le geôlier. Les
responsables de la distribution du repas continuaient à se
déplacer entre les groupes. Ceux qui étaient assis gardaient
les yeux fixés sur la porte ouverte du dortoir, sans
interrompre leur discusson. Certains se remettaient à manger
après des soupirs.
— Ils ont les nerfs fragiles, dit Zaki.
Il ne s’adressait à personne en particulier. On entendit des
rires çà et là. Tous s’imaginaient que quelque chose de très
drôle devait avoir lieu en ce moment même dans le dortoir
des Wafdistes.
Le docteur Mohamad revint assez vite. Il avait la tête
inclinée et un sourire aux lèvres.
— Rien de spécial, répondit-il aux questions qui fusaient de
partout.
Saïd bey
s’est évanoui.
Traduction de Dina Heshmat