Le magazine littéraire : Tous vos livres se passent dans votre pays d’origine, l’Egypte. Pourtant, depuis 45 ans, vous vivez en France. N’y a-t-il pas là une contradiction ?
Albert Cossery : Non, parce que je retourne souvent en Egypte. J’avais de la famille là-bas. De ma famille personnelle, maintenant, il n’y a plus personne, je suis le seul. J’ai encore des neveux, des nièces, de petites-nièces, mais mon dernier frère est mort il y a un an. J’ai presque 81 ans, je suis né le 3 novembre 1913.
— Vous vous sentez égyptien ou français ?
— Je suis toujours égyptien. J’ai un pays ! Je ne suis pas venu en France chercher un passeport ou un travail. Mais je suis un écrivain français. J’ai même reçu le prix de la Francophonie.
— Comment se fait-il que, né en Egypte, vous écriviez en français ?
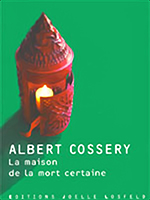
— Ça m’est venu naturellement, parce que c’était la langue de l’école. Tout ce que j’ai appris, je l’ai appris en langue française. C’est le hasard : petit, j’étais dans une école française. Mes frères étaient chez les pères jésuites, moi j’étais chez les Frères de La Salle, ensuite au Lycée français et on parlait français, sauf avec ma mère, qui ne parlait que l’arabe et ne savait ni lire ni écrire. Mon père lisait simplement le journal, il n’a jamais lu de livre. Mais à cette époque, l’intelligence c’était la littérature, la philosophie, ce n’était pas le minitel ! Je n’ai jamais lu de livre d’enfant. Dès que j’ai su lire, je lisais les classiques parce qu’ils étaient là. J’avais de grands frères qui étaient des intellectuels et je lisais ce qu’ils lisaient, parce que ça se trouvait à ma portée. Vous voyez que c’était un hasard merveilleux ! J’ai commencé à écrire à 10 ans : des romans d’après les films que je voyais.
— Le fait d’écrire en français ne vous a jamais gêné par rapport à ce que vous écriviez ?
— Non, il fallait trouver un style. Pour rendre la réalité égyptienne, je ne peux pas employer des expressions parisiennes, purement françaises. C’était ça le travail : rendre, en écrivant en français, l’atmosphère, la psychologie de personnages égyptiens. En me lisant, vous n’avez pas l’impression que c’est un français qui écrit sur l’Egypte !
— Vous avez écrit en arabe ?
— Non. J’ai oublié les deux autres langues, l’arabe et l’anglais. A Paris, avec qui voulez-vous que je parle arabe ! Quand je vais en Egypte, il me faut quelques jours pour retrouver la langue. En 50 ans, je n’ai parlé arabe qu’en Egypte. Quand mes frères venaient à Paris, on parlait français. En Egypte même, les noms des rues étaient en français, il y avait une très forte présence française. Beaucoup de ministres ont fait leurs études chez les Jésuites.
— Vous avez fait des études de quoi ?
— De rien du tout ! J’étais venu en France soi-disant pour faire des études, et je n’en ai pas fait.
— Avez-vous acheté un diplôme comme l’un de vos personnages (Teymour, dans Un Complot de Saltimbanques) ?
— Je n’en avais pas besoin, car je pensais que j’allais être écrivain. Quand je suis venu à Paris avant la guerre, j’avais déjà écrit des nouvelles publiées en français dans des revues du Caire, lorsque j’avais 17 ans, 18 ans. Ce sont les nouvelles qui ont ensuite été regroupées dans le recueil Les Hommes oubliés de Dieu, et quand le livre a paru pendant la guerre, il a été publié en français, en arabe et en anglais, et il est arrivé comme ça en Angleterre, en Amérique, en Algérie, où l’éditeur Edmond Charlot l’a découvert. J’ai donc signé mon premier contrat avec lui dès son retour en France après la guerre. Charlot était un très bon monsieur, c’est pourquoi il a fait faillite d’ailleurs. Vous savez, quand on est un monsieur bien et honnête, on fait faillite.
— Lorsque vous êtes revenu en France, en 1945, vous avez décidé d’y rester. Pourquoi ?
— Pour un écrivain qui écrit en français mieux vaut vivre en France pour plusieurs raisons que je n’ai pas besoin de souligner. Mais ce n’était pas le Paris d’aujourd’hui, un Paris américain dont je serais parti depuis longtemps s’il avait été comme ça à mon arrivée. Je reste, parce qu’à mon âge ça m’est égal que ça me plaise ou pas, je n’attends plus rien. Mais le Paris où je vis maintenant n’a plus rien à voir avec le Paris que j’ai connu, chaque soir, jusqu’au matin, dans ce quartier ... J’ai connu le Montparnasse d’avant-guerre, Saint-Germain-des-Prés après la guerre, les deux périodes de Paris les plus belles, donc, je n’ai rien à regretter ! Et puis, vous savez pourquoi on aime un pays : pour ses intellectuels. C’est Stendhal pour moi la France, c’est Louis-Ferdinand Céline, ce sont les plus grands écrivains !
— Il y a d’autres écrivains français qui comptent pour vous ?
— Quand je suis arrivé, il y avait dix, quinze grands écrivains en France. Jean Genet est peut-être l’un des derniers grands ou Julien Gracq. A l’époque, j’attendais le livre d’un écrivain avec impatience, je l’achetais le jour de sa parution.
— Vous avez un élément en commun avec Jean Genet : vous vivez à l’hôtel. Mais contrairement à Genet, qui en changeait souvent, vous vivez toujours dans le même, en plein quartier de Saint-Germain-des-Prés, depuis 45 ans.
— C’est le quartier où je m’amusais. Dans ma rue, il y a une boutique où l’on vend à manger et à boire, de quoi faire une fête jusqu’à deux heures du matin. Pour les cigarettes, c’est la même chose. Ailleurs ce serait l’exil, car je ne dors pas avant deux ou trois heures du matin (avant c’était cinq ou six heures du matin).
— Mais pourquoi l’hôtel ? Vous auriez pu trouver une chambre, un endroit à vous !
— Non, justement, je ne veux rien à moi. J’ai horreur de posséder. Sinon j’aurais été riche ! J’ai connu les plus grands peintres et sculpteurs. Ils m’ont donné des oeuvres parce qu’ils savaient que je les vendrais dès le lendemain. Je ne garde rien.
— De quoi avez-vous vécu ?
— En publiant des livres : je suis traduit dans toute l’Europe, en Angleterre, en Amérique et en Egypte (mais en Egypte, ça ne me rapporte rien). C’est assez étrange : je suis un écrivain inconnu, mais dont les livres sont réimprimés chez plusieurs éditeurs. J’ai également fait un peu de cinéma : des scénarios qu’on m’a donnés à refaire, des scénarios qu’on n’a jamais tournés. J’ai travaillé en particulier pour le cinéma algérien, au début de l’indépendance, quand il y avait une société d’Etat. De toute façon, ma vie c’est avec de l’argent ou sans argent, les mains dans les poches ! A partir du moment où vous pouvez marcher ... la seule chose vraiment mauvaise qui puisse vous arriver, c’est la maladie, parce que ça, c’est en dehors des hommes. Mais l’oppression que les hommes essaient de vous faire subir avec leurs idées, c’est de la foutaise. La seule chose qui puisse m’embêter, c’est de ne pas pouvoir me lever et sortir dans la rue. A part ça, rien n’a d’effet sur moi.
— C’est un changement radical de vie, car vous venez d’une famille riche ?
— Pas riche, aisée tout au plus, car riche, ça veut dire des milliards. On vivait très bien. Mon père était propriétaire foncier. Mon père n’a jamais travaillé, ni mon grand-père non plus : en Orient, quand on a de quoi vivre, on ne travaille pas. Ici, même quand on a des millions, on continue de travailler pour avoir plus ! Vous savez, nous — mes frères, mes soeurs ou moi — n’avons jamais dit « on va gagner de l’argent », mais « où trouver de l’argent ? ». Le mot « gagner » n’a jamais été prononcé. Quand on était jeune « trouver » de l’argent c’était taper mon père, taper ma mère pour ses bijoux, qu’elle nous donnait d’ailleurs, parce qu’une femme, en Egypte, tout ce qu’elle avait, c’était des bracelets.
— Que représente l’Orient pour vous ?
— L’Orient, c’est la philosophie. En Orient, les gens ont le temps de réfléchir, le moindre mendiant a une philosophie et une sagesse inouïes parce qu’il regarde le monde passer. C’est plus facile dans un pays de chaleur. Le climat joue beaucoup. Ce n’est pas de la paresse, c’est de la réflexion. C’est pourquoi je n’écris pas chaque année un livre, je reste six mois sans écrire pour laisser les choses arriver. Ne rien faire est un travail intérieur. Je travaille tout le temps. Quand je suis assis au café, seul, le garçon m’apporte le journal parce qu’il croit que je m’ennuie, et je lui dis « mais non, je suis avec Monsieur Cossery ! ».
— Vous écrivez au café ?
— Ah non ! Surtout pas ! Pour qui me prenez-vous ! J’écris une ligne chaque semaine. Si vous êtes lucide, c’est très difficile d’écrire, car vous savez que c’est mauvais. Je ne corrige pas mes épreuves, car je ne suis jamais content de ce que je fais. Je fais ce que je peux, mais je ne suis jamais content. Je peux écrire vingt lignes d’affilée, mais ensuite les corriger pendant deux mois. Chaque phrase est remise en question. Il n’y a pas de phrases pour rien dans mes livres. C’est un long travail. Je ne peux écrire que dans ma chambre. Quand je suis en voyage et que je suis à l’hôtel — je ne vais jamais chez des amis — je peux tout juste lire le journal, parce que je ne suis pas à l’aise. J’ai besoin d’un univers particulier pour écrire.
— Vous poursuivez un but en écrivant ?
— Je n’écris pas des romans pour raconter une histoire. L’histoire est là pour que je puisse dire ce que je pense, donc je suis un écrivain, pas un romancier. Les personnages sont là pour exprimer mes idées. Ce sont des gens que j’ai connus et qui pensent comme moi sur le monde, sur la vie. Il y a plein d’amour dans mes livres, mais ils ne racontent pas une histoire d’amour entre un homme et femme, parce que je ne crois pas à ces histoires. C’est pour ça que je ne vais plus au cinéma : comment voulez-vous qu’on s’intéresse à un monsieur qui aime une femme et qui a des ennuis avec elle parce qu’il en a toujours, sinon le film s’arrête. Mais pourquoi ? Si quelqu’un ne veut pas de moi, eh bien, tant pis, au revoir ! La vie est longue et il y a des millions de femmes !
— Vous avez été assez sévère avec les femmes dans vos livres !
— Mais pas avec les jeunes ! Quand j’étais plus ou moins jeune, c’était toujours les femmes de 16 ans qui m’attiraient. Une femme de 20 ans c’était une vieille !
— Avez-vous eu, tout de même, l’impression d’être un écrivain engagé ?
— Non, je n’ai jamais été membre d’un parti, pour la simple raison qu’on ne pourrait m’y supporter cinq minutes : je suis incapable d’être avec des gens. J’ai horreur des gens : quand je vais au jardin du Luxembourg, s’il y a des chaises autour de moi, avant de m’asseoir, je les enlève et je les mets loin, pour qu’on ne vienne pas s’installer près de moi !
— Mais vous pouvez vous amuser avec des gens tout de même ?
— Uniquement avec mes amis, des gens qui me ressemblent, qui regardent les jolies filles comme moi ...
— Qui boivent aussi ?
— Non, je n’ai jamais bu. Je n’aime pas les résultats que donne l’alcool. Je veux être lucide et les ivrognes m’ont toujours gâché ma soirée. Il y a très peu de gens qui peuvent boire et se conduire en gentlemen.
— Vous fumez aussi, le tabac, le haschich ?
— Le tabac oui, et je continue, malgré un cancer de la gorge il y a dix-sept ans. Mais le haschich, non, très peu et uniquement en Egypte, il y a longtemps : vous savez dans un roman américain on boit du whisky, dans un roman anglais on boit de la bière, alors dans mes romans on fume du haschich !
— C’est l’une des caractéristiques de l’Egypte ?
— Ce qui caractérise ce pays, encore plus, c’est l’humour. Les Egyptiens, chaque jour, inventent une histoire drôle sur l’actualité. Le moindre petit gosse que vous croisez dans la rue, vous raconte des choses amusantes, merveilleuses. Je n’ai rien eu besoin d’inventer ! Par exemple, j’ai un ami plus jeune que moi, qui a étudié à Paris. Sous Nasser, il a passé six ans en prison. Par la suite, il est devenu ministre du plan. Un jour, il était dans son bureau de ministre. Un huissier lui annonce qu’il y a là quelqu’un qui l’attend depuis le matin : c’était le policier qui le torturait pendant qu’il était en prison. Il avait perdu son travail depuis et venait solliciter un emploi : eh bien mon ami le lui a procuré, car, lorsqu’il le torturait, il faisait simplement son travail, donc il ne pouvait pas lui en vouloir ! Les Egyptiens sont un peuple pacifique.
Lien court: