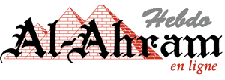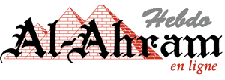Deux années de plus passèrent. On était en
juillet 1956.
« Vous avez entendu ? », demandait Pavlos. «
Nasser sera à Alexandrie demain. Il va faire un discours place
Mohamad Ali ».
Mon ami Pavlos était d’une famille de gauche.
Il était toujours très au courant des évolutions politiques et
suivait d’assez près les événements.
« On va y aller pour l’écouter », continua-t-il,
« et on emmènera le fils de Am Ahmad avec nous ».
On était en plein milieu de l’été. Un vent
chaud, comme du khamsin, venait de retomber, laissant la ville
pleine du souffle chaud du désert. Les dattiers étaient lourds
de fruits mûrs. Des grappes de dattes pendaient comme des
mamelles lourdes de vaches attendant d’être traites. La plus
légère brise pliait les troncs d’arbres, faisant rapprocher
leurs faîtes les unes des autres dans un air de conspiration,
comme s’ils échangeaient des messages secrets sur ce qui allait
se passer. L’odeur douce du foul et du jasmin était si forte
qu’elle semblait vouloir rendre les gens fous. Et pourtant,
personne n’y prêtait attention. Les gens semblaient ne pas la
remarquer. Ils restaient opiniâtrement penchés sur leurs
appareils radios. Ceux qui savaient lire avalaient goulûment les
journaux. Ils essayaient de saisir ce qui se passait. Ils
arboraient des expressions sévères, inadaptées à leurs visages
égyptiens si gais, et discutaient des événements en chuchotant.
« Cela fait quatre ans depuis la Révolution
», dit Pavlos. « La nation attend toujours des jours meilleurs.
Les gens ont toujours faim ».
C’était vrai. Bien sûr, de gros efforts
avaient été fournis. Mais, comme le disait Ismaïl, « les choses
ne changent pas d’un jour à l’autre. Ça prend du temps et de la
patience. On ne veut pas perdre le peu qu’on a ».
Les étrangers se méfiaient de la Révolution.
« Si Nasser réussit, d’autres pays sous
domination étrangère suivront son exemple. Il y aura des
révoltes partout ». Pavlos disait cela avec une expression très
intense sur le visage, à voix haute, comme s’il était en train
de faire un discours. Je regardais autour de moi pour vérifier
s’il parlait peut-être à d’autres gens, mais on était seuls.
« Tu as raison, Pavlos », dis-je, « mais
aller au meeting pourrait nous causer des problèmes.
Rappelle-toi la dernière fois, à la manifestation pour
l’indépendance de l’Algérie. Quand le chawich, le gendarme est
apparu, tu as déguerpi et je me suis pris des coups ».
« Ne dis pas n’importe quoi. Les choses ont
changé depuis. Tu n’as rien remarqué ? ». Il dit cela sur un ton
d’une certitude désarmante, comme s’il était stupéfait par ma
naïveté.
Nasser voulait construire un Haut-Barrage à
Assouan. Ce sadd al-ali était devenu une obsession pour lui. Il
voulait dompter les eaux du Nil qui allaient se jeter dans la
mer. Si on construisait un barrage géant, le flux pourrait être
contrôlé, et d’immenses portions du désert, pourraient, d’après
les experts, être irriguées. Les gens, alors, n’auraient plus
jamais faim.
Mais les coffres étaient vides. L’Egypte
cherchait de l’aide auprès de l’Occident et avait demandé à la
Banque mondiale de financer ces « Grands Travaux ». Il semblait
que l’Amérique et la Grande-Bretagne étaient de prime abord
assez positives sur le barrage, mais plus le temps passait, plus
elles traînaient des pieds. La nation attendait, le souffle
coupé. Le discours de Nasser à Alexandrie, aurait, selon eux,
une signification extrêmement importante. Une multitude de gens
étaient venus de tout le pays pour écouter parler le raïs :
jeunes, vieux, enfants aussi, mais très peu de femmes, vu
qu’elles restaient le plus souvent à la maison pour ce genre
d’occasion.
Ils arrivèrent par train, par bus, par tram,
en carriole, à dos d’âne, à pied. Très tôt dans la matinée, ils
commencèrent à se rassembler dans les gares, les parcs, les
places, devant les mosquées et les cafés. Dans l’après-midi, ils
se dirigèrent vers l’immense place. Ils approchaient comme des
essaims de criquets : d’une dizaine, ils furent bientôt une
centaine, puis un millier et grossirent jusqu’à devenir une
multitude.
Quand on arriva à la place, c’était bondé
d’Egyptiens. Aussi loin que le regard pouvait porter, il n’y
avait que des turbans blancs, que portaient ceux qui étaient en
galabiya, les quelques tarbouches rouges avec leur gland noir
portés par ceux qui étaient à la mode européenne, beaucoup de
taqiyas — ces petits bonnets blancs ou gris foncé — et beaucoup
de têtes nues et sombres, défiant le soleil sauvage. Aucun
Européen n’était visible. Ils étaient nerveux, étaient restés à
la maison, s’entretenant une fois de plus des temps révolus, des
révoltes et des horribles méfaits des locaux qui faisaient
dresser les cheveux sur la tête. Toutes ces histoires me vinrent
subitement à l’esprit, et je me demandai s’il y aurait à nouveau
du grabuge.
A mesure que l’heure d’arrivée du président
approchait, la vague de corps enflait, et un rugissement montait
de la foule, comme une marée en colère. Les masses ne pouvaient
plus être contenues dans les limites de la vaste place en pierre
et commencèrent à dépasser sur les rues attenantes, inondant les
ruelles et s’étendant à flots, plus loin en direction de la côte.
Puis, un chuchotement monta, il se fit de plus en plus fort
jusqu’à devenir un bourdonnement assourdissant : « C’est lui !
Il est ici, il est ici … ».
Quelle effervescence ! De là où j’étais, je
pouvais voir Nasser. Une grande silhouette, debout sur un balcon,
les bras étendus, saluant la foule. Tout le monde sautait sur
place. Emportés par l’ambiance, Pavlos et Badri se joignirent au
mouvement. Les paysans, les Saïdis, sautaient aussi sur place,
brandissant leurs bâtons au-dessus de leur tête comme des épées.
Puis, le moment vint : la voix du leader,
calme, sereine, ferme, monta à travers les petits mégaphones.
D’un coup, la foule tomba dans le silence, pendue à chaque mot
de Nasser. Pas un bruit. On était murés, immobiles, comme
pétrifiés, comme si dans cette immense place le révolutionnaire
passionné et le cavalier de bronze, apparemment impuissant sur
son haut piédestal, se faisaient face, seuls, comme des
gladiateurs à la mode ancienne.
Pavlos avait fait remarquer que la statue
montée de Mohamad Ali, le fondateur de la dynastie que Nasser
avait abolie, devrait être abattue. « C’est un symbole de
l’oppression. Elle doit partir », disait-il.
Je ne dis rien, mais je pensais : « ça serait
une honte qu’une si belle sculpture soit perdue ». Heureusement,
la statue montée du pacha a survécu.
A mesure que le discours avançait, la voix de
Nasser montait. Maintenant, il expliquait aux gens, sur un ton
irrité, le refus des étrangers de financer le bâtiment du grand
barrage d’Assouan. « On a demandé de l’argent pour construire le
sadd al-ali, mais le président de la Banque mondiale, M. Black,
a prouvé qu’il avait l’âme aussi noire que son nom. Ils nous ont
refusé l’argent. Ils ont refusé le bien-être au peuple égyptien.
Mais nous construirons notre grand travail. Notre patrie
continuera son chemin vers son destin ».
Il fit une pause, et ajouta, la voix
puissante, insistant sur chaque mot : « J’annonce maintenant la
nationalisation du Canal de Suez. Ce canal nous appartient, et
les revenus des taxes payées pour y passer construiront notre
barrage ».
La place était figée. Le public réalisa qu’il
était en train de vivre un moment historique. Il y eut une
pause, qui sembla devoir durer pour toujours, comme si tout
était suspendu en l’air. Et alors la foule commença à acclamer,
scandant, encore et encore : « Gamal, Gamal, Gamal ». Gamal
Abdel-Nasser avait osé défier les superpuissances, la
Grande-Bretagne et la France.
Le président parla pendant un petit temps
encore, mais on ne l’entendait plus à cause du vacarme des
festivités. C’était un éclat de fierté oppriméqui avait mitonné
pendant des années dans cette immense marmite en granit. Nasser
s’en alla. La nuit tomba, mais la foule ne quitta pas la place.
Les gens étaient emportés par une passion sacrée. Personne ne
voulait partir et la place, toute en pulsations, refusait de se
vider.
Combien de temps ont duré les festivités ? Je
ne sais plus. Le temps semblait s’être arrêté. A un certain
moment, la place fut encerclée par des pompiers avec des pompes
à eau qui douchèrent la foule. Tout le monde fut calmé.
Transporté, Pavlos gesticulait comme un sauvage, complètement
emporté par son enthousiasme. Badri aussi. Il ne réussissait pas
à contenir sa joie et disait qu’il allait s’inscrire
immédiatement auprès des forces armées.
Traduction de Dina Heshmat